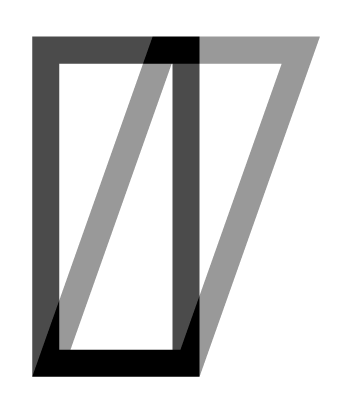Commissaire : Gilles Daigneault
En 1979, Molinari présente ses Quantificateurs au Musée d’art contemporain de Montréal. Notons qu’il s’agit là de son premier solo dans cette institution dont il s’était tant soucié de la création à l’époque. La chose intervient plus de dix ans après la participation, très réussie, de l’artiste à la 34e Biennale de Venise (1968) et à l’importante exposition The Responsive Eye, présentée au MOMA (1965).
D’entrée de jeu, le nouveau travail de Molinari a de quoi surprendre : par comparaison avec la production de la décennie précédente, les dix-sept Quantificateurs, sombres et parfois de formats démesurés (il y en a trois qui font 308 cm sur 660), sont remarquablement dépouillés et exigent du regardeur une observation patiente, une lecture méditative. Ils sont tous datés de 1978 et 1979. Faut-il rappeler que, depuis la fin de sa période des tableaux à bandes verticales de largeur égale (qui vont l’occuper de 1963 à 1969), Molinari se donne des échéances plus courtes. Tout se passe comme si— avec ses propositions de colonnes tronquées ou de damiers, qui réintroduisent l’horizontale, et diverses formes de triangulation — il était en transit, dans l’attente d’une nouvelle structure spatiale qui réponde à des exigences plus profondes et plus complexes, plus durables aussi.
De ce point de vue, le corpus des Quantificateurs pouvait apparaître comme une nouvelle tentation du peintre, volontiers aventureux à l’époque, peut-être moins affirmatif, en tout cas plus imprévisible. C’est ainsi que Molinari avait présenté, quatre ans plus tôt, ses séduisants Triangulaires au Centre culturel canadien, à Paris, un ensemble de sept grandes toiles qui dénotaient, comme l’écrivait dans le catalogue le grand écrivain d’art Bernard Teyssèdre, « une composition merveilleusement équilibrée aux rythmes instables, au chromatisme harmonique et raffiné ». Une sorte de classicisme, en somme, comme en connaissent de loin en loin les créateurs les plus radicaux. « Ses récents tableaux sont follement beaux », continuait Teyssèdre à la fin d’un texte qui demeure une des meilleures analyses de l’œuvre du peintre. « Ce qui les sauve du grief d’être trop beaux, c’est qu’ils le sont “follement”. Molinari n’a que quarante ans, il a mérité qu’un travail exemplaire débouche sur une phase d’équilibre apaisé. Les nouveaux départs qui peut-être se préparent, bien téméraire qui pourrait les deviner, sauf pour en dire ceci : que Molinari n’a pas fini de nous surprendre ». Le commentateur le plus pénétrant de l’œuvre du peintre ne croyait pas si bien dire, lui qui, professeur invité à l’Université de Montréal en 1967, avait pourtant vécu un trimestre entier dans son atelier, rue Visitation. « J’étais entouré, se souvient-il, par l’œuvre de Molinari. Ses tableaux, ses dessins, un à un, nous les avons regardés ensemble, analysés, discutés, presque chaque jour, et souvent plusieurs heures d’affilée. Ces débats d’idées, tantôt ironiques, tantôt véhéments, toujours chargés d’une intense présence humaine, m’étaient devenus nécessaires ».
De son côté, Molinari y gagnait un vrai interlocuteur, ce qu’avait été pour lui Rodolphe de Repentigny au cours des années cinquante. Bref, personne ne pouvait prévoir que l’écriture picturale de Molinari allait glisser vers les Quantificateurs, en passant par une courte série de Trapèzes portant discrètement les signes d’une orientation vers un univers plus intérieur, plus intime. On repense à l’hommage que rendait David Burnett, un autre exégète de haut vol du travail de Molinari, au corpus qu’il avait réuni au MACM en 1979 : « Car c’est une chose que de maintenir une intégrité créatrice dans un ensemble de peintures de petit format ou dans des dessins; mais être capable de soutenir cette intensité tout au long de dix-sept tableaux aussi grands que ceux-ci est une réussite aussi remarquable qu’elle est émouvante ». Or, l’aventure s’étendra, principalement avec des séries en rouge puis en bleu (« ma période mystique », dira Molinari en souriant), sur une bonne vingtaine d’années, de loin l’échéance la plus longue qu’aura expérimentée l’artiste, avec des points d’orgue particulièrement enveloppants pour les spectateurs : les quatre panneaux rouges de Danse soupir, présentés à son atelier en 1987, et les sept bleus de Vent bleu, au MACM en 1997.
À la Fondation Guido Molinari, on a toujours eu un faible pour ces pages qui ne se livrent pas ouvertement, qui constituent autant d’ambiguïtés, comme l’a bien vu Roald Nasgaard: « Nous n’arrivons jamais à une définition de la forme discrète, et toujours à la dissolution de la forme : une mise en suspens continuelle pouvant conduire le pessimiste au désespoir spirituel, ou encore ouvrir à l’optimiste la porte des possibilités nouvelles ». (1995 MACM catalogue)
– Gilles Daigneault